Fenêtre sur Hodler. Episode 3: Delphine Reist
Delphine Reist, 21 juin 2023. Delphine Reist, Genevoise d'origine valaisanne, est venue présenter une exposition au FRAC Grand Large à Dunkerque qui venait de se terminer. C'était l'occasion de parler du processus de réalisation de son travail en montrant pour la première fois une série de dessins préparatoires.
6/22/20239 min read
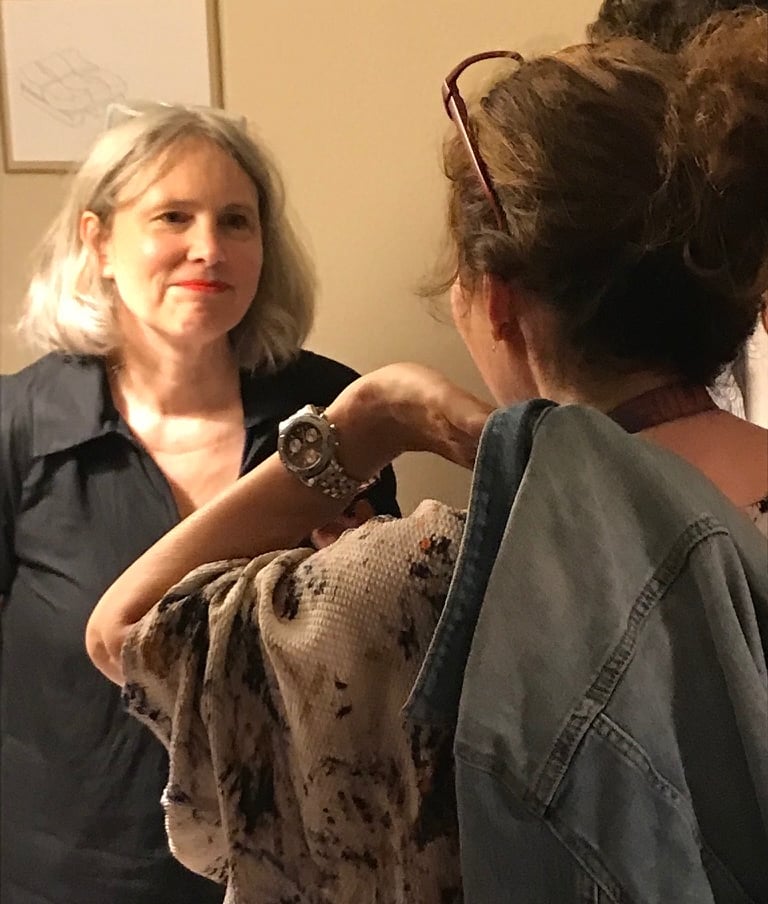

Fenêtre sur Hodler #3
Delphine Reist
21 juin 2023
Le travail de Delphine Reist a été un de mes baptêmes en art contemporain. Dans ce sens, on peut dire que Delphine est une de mes marraines, ou en langage professionnel, une de mes mentors.
En 2006, Eliane Valterio montrait une fontaine d’huile de vidange dans sa galerie Le Dépôt d’art contemporain à Sion. La pièce de Delphine Reist s’intitulait Rocaille. Une rocaille, c’était un mot que j’entendais souvent dans la bouche de ma mère et qui désignait un jardin d’ornement, faussement sauvage, où les plantes créaient un paysage pittoresque en alternance avec des rochers et de la mousse. D’un autre côté, le département d’histoire de l’art moderne m’avait appris que rocaille renvoie à un style du 18ème siècle français, un joli mot pour dire rococo, ou baroque. Que cela puisse désigner de l’huile de vidange et des bidons de plastique m’a un peu étonnée, mais pas tant que ça, puisque cela faisait six ans que j’interviewais artistes et commissaires d’expositions pour la rubrique culturelle d’un journal local. L’huile formait de mignons jets, l’association entre l’image et le mot m’a fait sourire, et j’ai trouvé la galeriste courageuse devant les taches d’huile qui s’élargissaient[1].
En 2008, j’étais parmi les visiteurs du chantier du collège Sismondi à Genève où Delphine Reist et Laurent Faulon avaient créé une énorme exposition réunissant machines trépidantes, bidons d’huile (encore) et installations de tables en plastique. Laurent Faulon sautait nu d’une table à l’autre, des fûts de métal dévalaient bruyamment les couloirs et les collégiens se mêlaient aux ouvriers pendant le vernissage.
Il y a eu 2009, l’année faste de l’exposition Elles@centrepompidou, Artistes femmes dans les collections du Musée national d’art moderne, où Delphine était présente avec sa vidéo Averse. Dans un espace industriel neutre, les néons tombaient les uns après les autres jusqu’à l’obscurité totale. Et puis Fête Nat’ à la Ferme-Asile à Sion en 2011, une exposition en duo, a marqué la consécration valaisanne de cette artiste née à Sion mais qui avait grandi au bout du lac. Chaque fois, un nouvel entretien me donnait d’autres clés pour entrer dans cette œuvre. L’étape sédunoise a été étrange, c’est ma ville, et la ville des parents de Delphine. Je voyais les allusions à l’esthétique de kermesse, la critique sociale et l’humour du propos. Pour la première fois, je me suis demandé la part d’autobiographie qu’il y avait dans ces pièces.
A ce moment, je commençais vaguement à comprendre où Delphine Reist voulait en venir avec ses scies sauteuses, ses bidons et ses chaises à roulettes, tous ces machin(e)s qui crachotaient, tressautaient, giclaient et patinaient, et je l’avais contactée dès la mise en route de ma première exposition en tant que commissaire. Elle m’avait conseillé de choisir trois artistes, j’en avais contacté douze et ils avaient tous accepté de participer. Mon exposition était un gros bazar autour du thème du jeu, du hors-jeu, du « pas du jeu ». Dans un catalogue que je n’ai lu que longtemps après, Delphine a déclaré qu’elle n’était pas « toujours fan des expositions collectives où les œuvres sont juxtaposées sous couvert d’une thématique »[2]. J’avais présenté son Discours, une série de micros avec des mirlitons qui trompétaient de manière aléatoire. Cela me semblait convenir à ma nouvelle activité. J’aimais l’esprit Dada de cette pièce, son humour, son absurdité, qui posait Delphine en héritière de Meret Oppenheim.
En 2012, Delphine et son mari Laurent Faulon ont postulé pour une résidence de dix mois à l’Institut suisse de Rome. De mon côté, j’obtenais de mon rédacteur en chef un billet pour la Ville éternelle. L’entretien, malgré sa sécheresse journalistique, rend quelque chose du décalage entre le travail du couple et les ors de la Villa Maraini. Delphine Reist et Laurent Faulon cherchaient les interstices de la ville. Ils s’étaient sentis chez eux dans le vieux Teatro Valle occupé par les artistes depuis que la Ville y avait coupé ses subventions : « Par le passé, Laurent et moi avons organisé nos propres résidences en invitant des artistes à nous rejoindre dans des lieux de vie temporaires, souvent précaires, où tout était à faire. Petit à petit, c’est devenu un outil… » Et à propos de l’Institut suisse : « Nous n’avions pas besoin d’autant de luxe, mais nous apprécions l’avantage de rencontrer artistes et scientifiques sous le même toit, sans rapport de hiérarchie entre artistes et historiens de l’art…Nous sommes débarrassés du souci de gérer le quotidien pour nous concentrer sur le travail. »[3] Cette parenthèse de « luxe » romain comme disait Delphine, n’a pas été répétée. Très vite, elle est retournée à ses friches, à ses chantiers, à ses zones industrielles. C’était là que fleurissait son travail, dans le béton, les matériaux bruts, les banlieues déshéritées, les environnements précaires, des lieux qui racontent certains aspects d’une société.
Et évidemment, en bonne héritière de l’exposition d’Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne Quand les attitudes deviennent formes de 1969, Delphine s’est glissée à la suite de ces artistes dynamiteurs d’institutions lorsque son tour est venu d’y être invitée. En 2013, elle démolissait le plafond du MAMCO pour son installation La Chute. Dans les mêmes espaces, elle présentait des sacs d’enfants vibrants et solitaires, accrochés à des crochets de vestiaires comme des petits animaux calibrés et écartelés (Patères, 2013).
Entre 2014 et aujourd’hui, le travail de Delphine Reist a pris de la visibilité. Les résidences sauvages des débuts, à Lisbonne, en Estonie, en Russie etc., ont fait place à des invitations dans des grandes institutions en France et en Suisse. Après le FRAC Grand Large à Dunkerque qui l’a reçue en 2022, elle prépare pour l’automne 2023 une exposition personnelle au Musée Tinguely à Bâle. Elle enseigne à la HEAD à Genève et partage un atelier avec Laurent Faulon à Picto, une association auto-gérée qui propose des espaces d’expositions et de production, ainsi que des résidences.
LES DESSINS
Leur atelier leur sert à la fois de bibliothèque, d’archive, de stockage et d’espace de travail. Lors de ma venue, Delphine avait préparé une table pour me montrer ses dessins. Elle ne les avait jamais exposés. Je ne les avais jamais vus. C’est lors de nos discussions pour préparer cette rencontre dans mon salon, ce troisième épisode de Fenêtre sur Hodler, que la question du dessin est apparue.
Delphine Reist dessine sur des feuilles volantes de provenances diverses, souvent des papiers très simples comme on en utilise dans une imprimante. Le trait est précis, sobre, sans fioriture. Il trace un espace et les contours d’une œuvre. Chaque dessin est photocopié plusieurs fois et devient une base pour de nouvelles variations. Les feuillets varient légèrement, par la place des objets, le choix des couleurs ou des matériaux, feutres, stylo, crayon. Le dessin de base peut être enrichi, transformé par des collages, des découpages. Seul l’espace, une fois posé, ne bouge plus.
Le processus de création d’une œuvre est presque tout entier dans ces dessins.
Je suis frappée par la clarté du trait, sa précision. Et aussi par l’économie de moyens.
Elle commence par des croquis dans son carnet « souvent sur le vif ou dans le train ». Elle met ensuite ses dessins au propre sur une feuille A4, toujours à main levée, mais à la manière du dessin technique. « Je les fais en série en laissant divaguer mon esprit et à la fin je garde celui ou ceux que je trouve pertinents pour le projet. C’est un outil qui me permet de présenter mes idées aux personnes avec qui je travaille. Comme on ferait une maquette ». Ces dessins préparatoires viennent tôt dans le processus de création d’une exposition. Ils révèlent le cheminement de sa pensée. Après le dessin, vient la maquette, elle aussi très précise, avec les espaces, les circulations dans le bâtiment, les œuvres à l’échelle, posées à leur emplacement définitif.
Mais ce sont les dessins qui permettent de préciser une pensée.
Elle n’a jamais montré ses dessins, parce qu’elle ne les considère pas comme des œuvres. A quel moment un dessin devient-il une œuvre ? J’ai posé la question à ChatBot GPT le 16 juin 2023. Voici ce que la machine m’a répondu : « La réponse est subjective et dépend de l’interprétation de chacun. Certains considèrent que tout dessin créé par l’artiste est une œuvre d’art, tandis que d’autres estiment qu’un dessin devient une œuvre d’art quand il est exposé et montré au public ». Le robot citait ensuite pêle-mêle Picasso, William Kentridge et Rachel Witheread…
Pour nous autres étudiantes en histoire de l’art, le dessin a longtemps été étudié comme une œuvre d’art. Un dessin pouvait révéler l’auteur d’une peinture, être un exercice dans le jeu des attributions, être collectionné, acheté et vendu pour des sommes mirobolantes. Les règles ont changé avec l’arrivée de la photocopieuse et de l’exposition de Mel Bochner à la Yale University Art Gallery en 1966, Working Drawings and Other Visible Things on Paper Not Necessarily Meant to be Viewed as Art[4]. Cette exposition de dessins photocopiés et présentés dans des classeurs (sur un socle tout de même) a remis en question le statut du dessin en tant qu’œuvre d’art et l’a renvoyé au rang d’une archive ou d’un marqueur du processus de création. La photocopieuse a également influencé le rendu des dessins préparatoires (ou working drawings). La photocopie exigeait un dessin graphique, précis, sans trop de détails. Les subtilités de tons ou de couleurs étaient perdues dans le processus de reproduction[5]. L’œuvre y a perdu son aura, comme Walter Benjamin l’avait souligné dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique paru en 1939. Mais Benjamin avait aussi anticipé sur le fait que ces nouvelles techniques finissent par s’imposer comme de nouvelles formes d’art. L’exposition de Mel Bochner en 1966 marque les débuts de l’art conceptuel. L’année suivante, un groupe d’artistes réalisait Untitled (Xerox Book), un livre tiré à 1000 exemplaires à partir de photocopies de dessins. Le livre constituait pour eux un nouveau format d’exposition[6].
Les dessins présentés ce soir évoquent l’exposition de Dunkerque. Ils tracent aussi un fil entre plusieurs installations réalisées dans des lieux différents et montrent comment une idée est recyclée, développée et reprise avec des variantes d’une exposition à l’autre. Par leur esthétique, leur mode de production, leur aspect sériel, par bien des aspects ces dessins sont constitutifs du travail d’installation de Delphine Reist. On y suit la construction d’une image à partir d’une idée. Ils révèlent l’humour toujours présent, la recherche inlassable, la méticulosité d’une préparation. Et à la question, à quel moment un dessin devient une œuvre, la réponse pourrait être : à partir du moment où son auteur lui donne le statut d’œuvre. Ou encore, who cares ?
Véronique Ribordy
Prochainement :
17 octobre 2023, 18h30, vernissage de l’exposition de Delphine Reist « ÖL (oil, olio, huile) », au Musée Tinguely, Bâle. A voir jusqu’au 14 janvier 2024
[1] Quand elle a lu mon texte, Delphine Reist m’a dit que ce titre lui avait été inspiré par sa grand-mère, propriétaire d’un jardin où, comme ma mère, elle soignait sa « rocaille ».
[2] Corinne CHARPENTIER, « Honore le travail, respecte le travailleur » in Delphine Reist, ed. Les Presses du réel, 2011, page 81
[3] « Résidence romaine », Véronique Ribordy, in Le Nouvelliste, 5 mai 2012
[4] James MEYER, “Mel Bochner, Working Drawings And Other Visible Things On Paper Not Necessarily Meant To Be Viewed As Art, 1966,” in The Artist As Curator: An Anthology, Elena Filipovic, Milan, ed. Mousse, 2017, page 35.
[5] Voir par exemple Anna LOVATT, “Ideas in Transmission: LeWitt’s Wall Drawings and the Question of Medium“, in Tate Papers n°14, Autumn 2010, https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/14/ideas-in-transmission-lewitt-wall-drawings-and-the-question-of-medium, consulté le 14.06.2023
[6] Laurence Weiner, Robert Morris, Joseph Kosuth, Douglas Huebler, Robert Barry, Sol LeWitt, Carl Andre. Untitled (Xerox Book), 1968, ed. Seth Siegelaub and Jack Wendler
